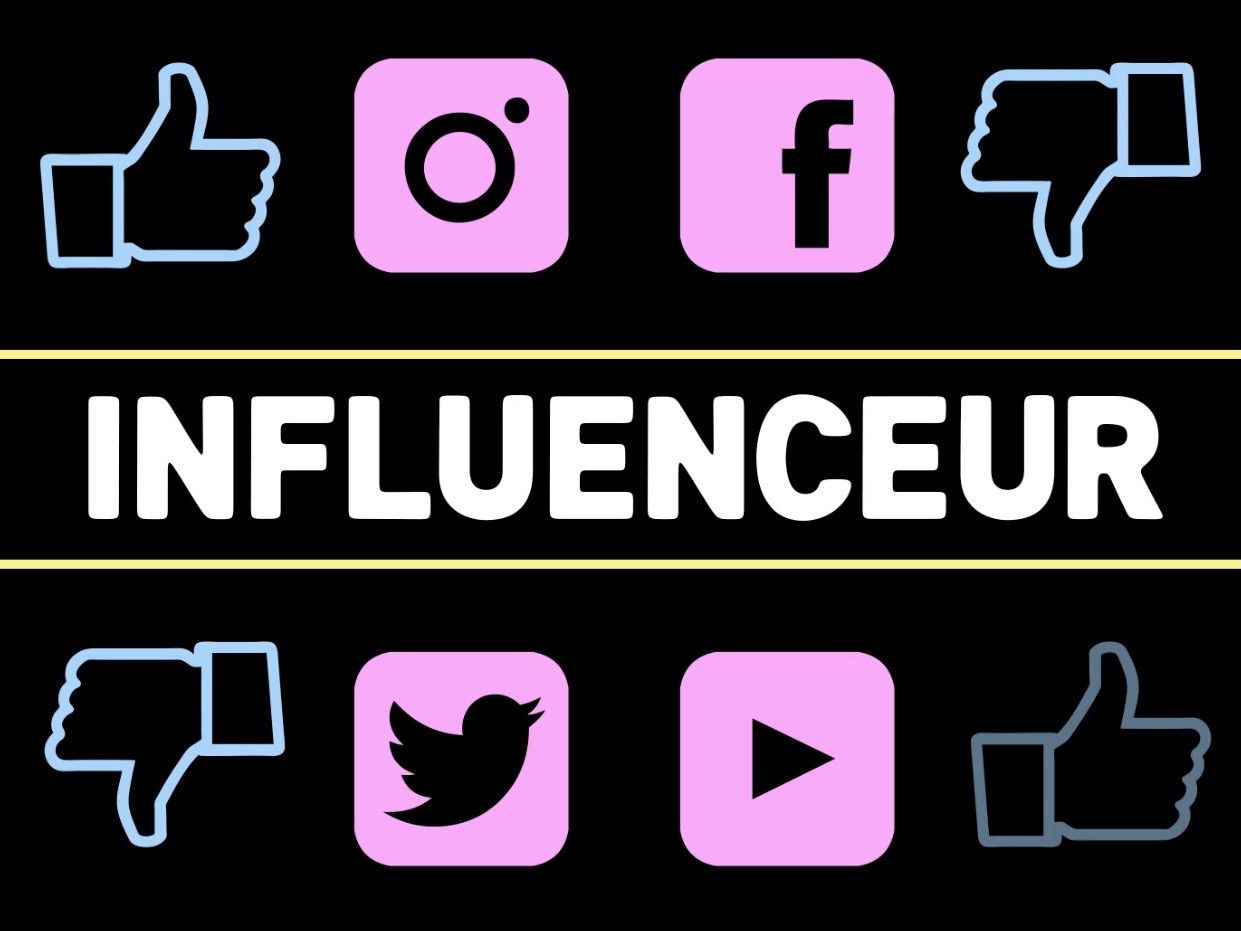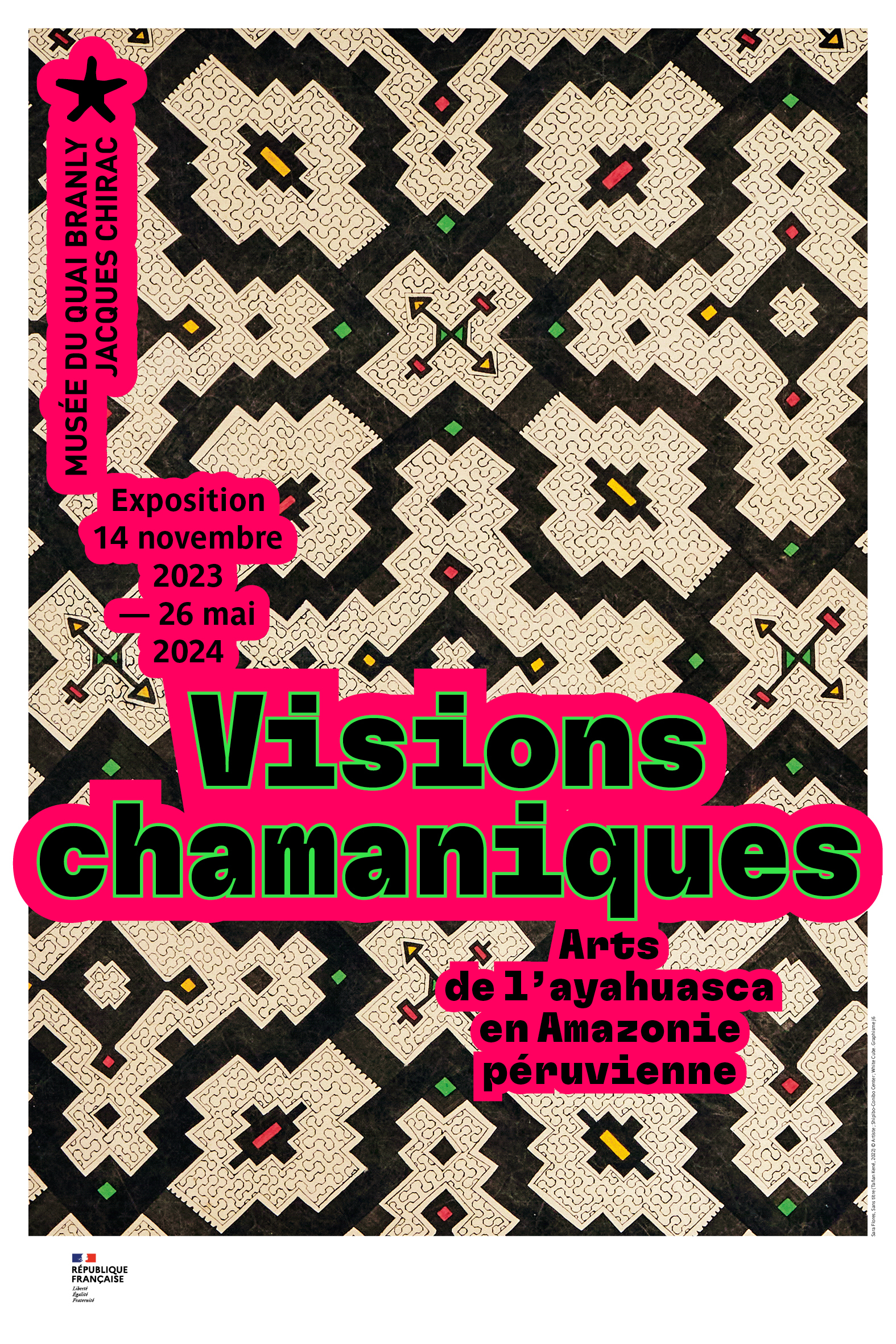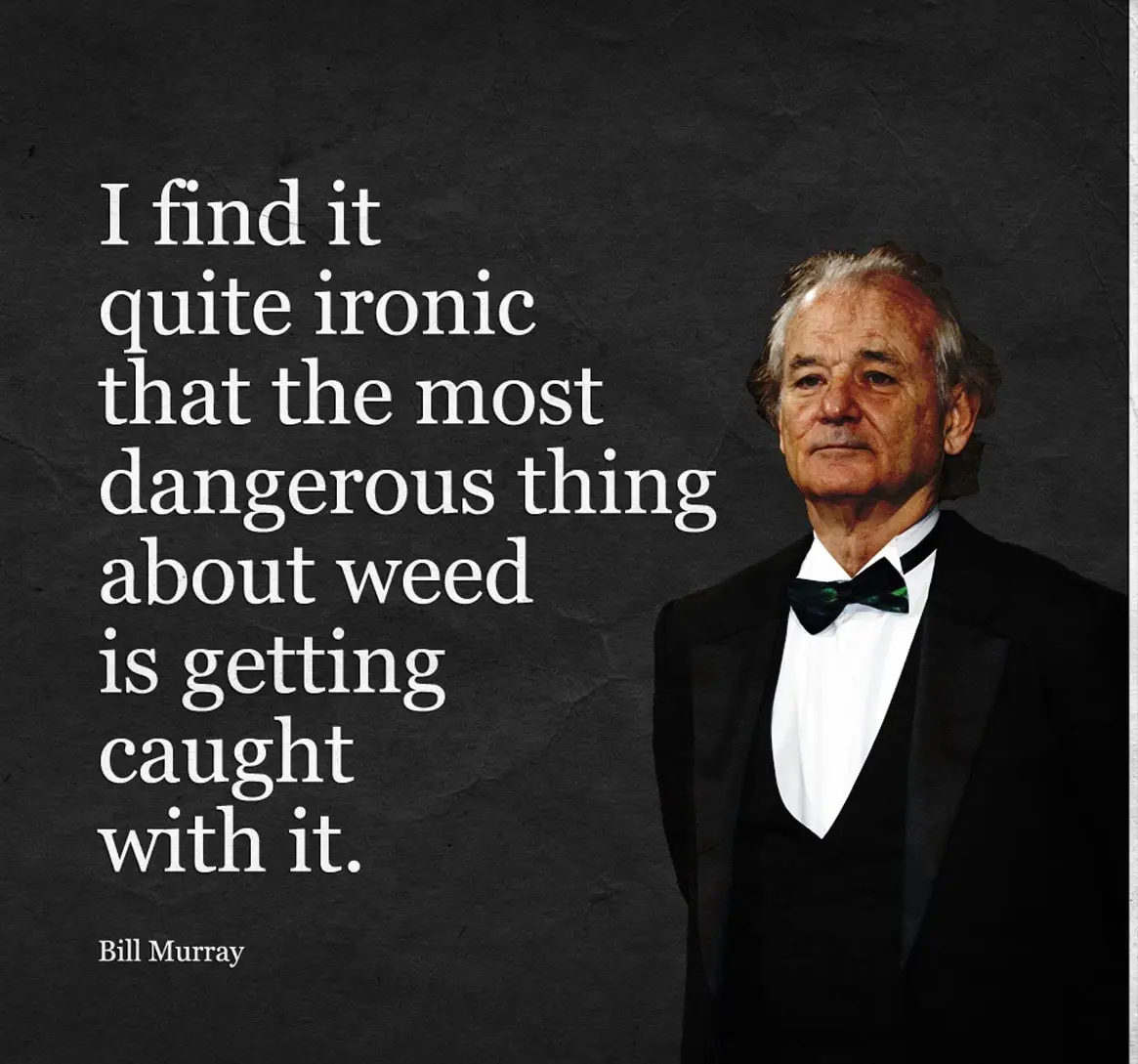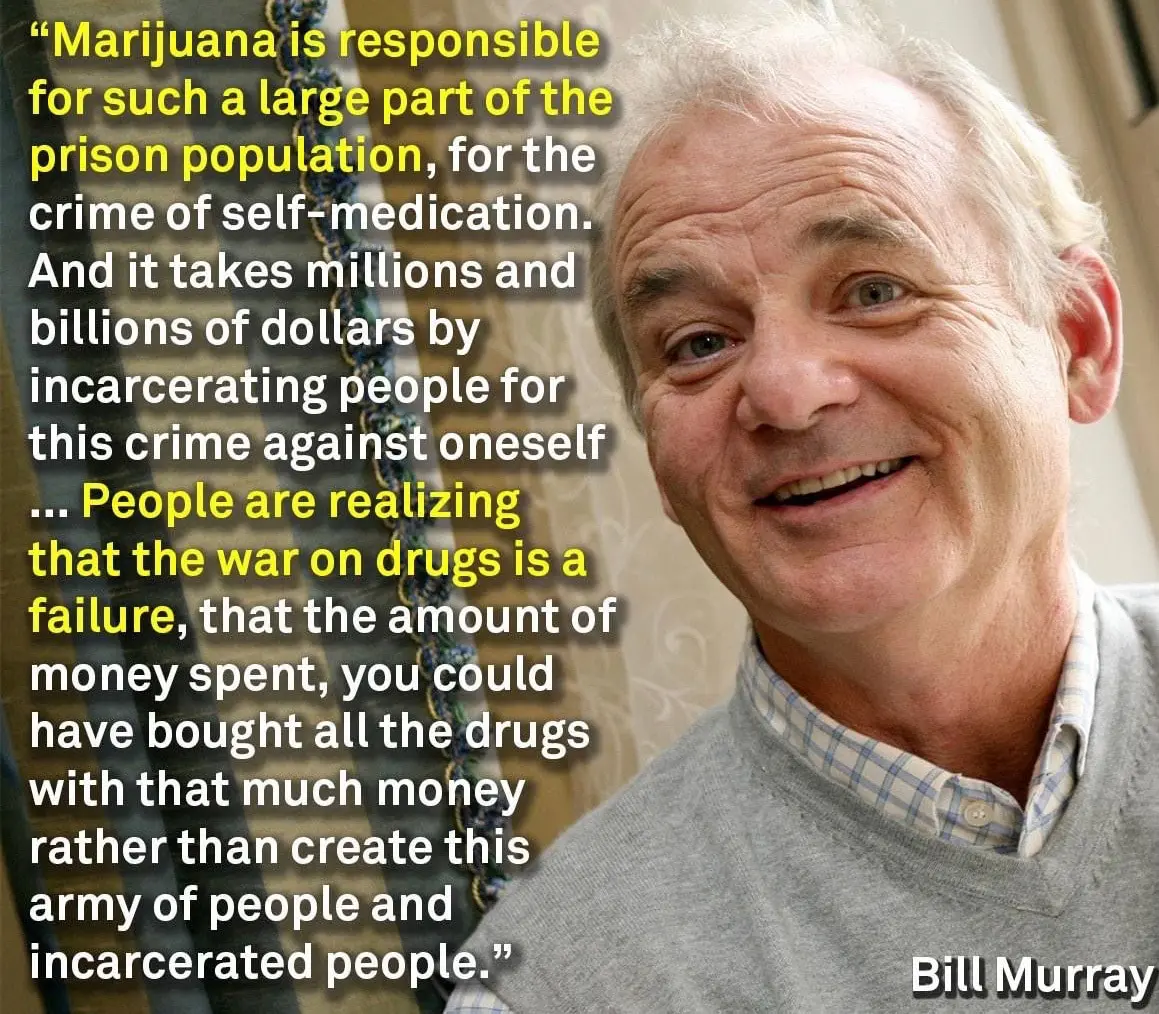Maman dit que j’ai des velléités de révolutionnaire. Je crois qu’elle a raison. Je dois tenir ça de mon grand-père, pour qui un homme qui vaille est un homme qui marche et dont les godillots restent intacts.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Ah l’époque… Drôle d’époque… Surtout pour ceux qui pensent que c’était mieux avant.
Si pour certains la route est longue quand le souffle est court, rien n’est jamais trop grand pour ceux qui espèrent l’inspiration nouvelle venant corriger les impertinences contemporaines.
Et moi et moi et moi…. ?
À force d’écouter Dutronc, et son constat sur les 700 millions de chinois, je me demande quand même ce que je fais là, entourée de tous ces bars tabac…
Il faudrait un heureux tintamarre, un étendard, que je placarderai dans les rues, comme la révolution invisible de John Hamon, l’homme à la gueule la plus connue de Paris.
Pour mener à bien ce cri d’alarme, voici le petit précis des germanopratins en 10 commandements bien distincts :
- Se lever du bon pied, donc toujours celui de gauche !
- Une noble révolution est avant tout celle qui éclot dans un bon QG car « ce qui n’a pas lieu n’existe pas ». De préférence celui-ci sera le Balto, tour de contrôle, centre névralgique et nerf de la guerre dans le haut lieu du 6e arrondissement de Paris…
- Le révolutionnaire porte généralement une chapka comme vestige de la révolution russe. Il sera né de préférence le 7 novembre, date du jour de la révolte de 1917 convertie au calendrier grégorien. Il faut bien vivre avec son temps… On pensera tout de même à cacher les livres sur l’écriture inclusive de sa petite sœur (déjà que nous n’avons pas le monopole du cœur il faut bien placer certaines limites…)
- Le dimanche c’est jour de messe mais revisité à la mode de chez nous. Rendez-vous au QG avec toute la meute du quartier et même ceux qui proviennent des contrées éloignées dont on ne retient jamais le nom. Après tout, pourquoi s’encombrer quand on peut faire simple ? Au travail ! Car chez le révolutionnaire pas de quartier (sauf le 6e évidemment) mais on ne veut tout de même pas « perdre notre vie à la gagner ».
- Nous recommandons en boissons plutôt l’absinthe que la bière qui est trop vulgaire et préférons une bonne levée de coudes plutôt qu’une levée de fonds.
- Pas le temps de battre le pavé, ici on le jette. Ce n’est pas pour insister sur le côté « germano latin » mais révolution vient de revolutio, le retour. Allez hop, un petit tour sur nous même, direction mai 68. « Sous les pavés la plage » n’est-ce pas ? Tant mieux. On finira par y acculer l’ennemi (ça fera des vacances à tout le monde…) et en plus c’est congés payés, chacun y trouve son compte.
- Nous ne sommes pas pour les grandes messes, mais il faut bien le dire quand même que si y a un saint qu’on vénère, c’est bien Saint Germain.
- Nous chanterons tous volontiers la « carmagnole » ou « bella ciao », et prierons pour ne pas être vulgairement confondus avec les fanatiques de la « Casa del Papel » ou tout individu qui consomme la culture comme on goberait un macaron. Vous pensez que je suis snobe vraiment ? Mais rappelez-vous que Boris Vian ne jurait lui aussi que par Saint Germain, coïncidence ? Je ne crois pas.
- Nous menons notre révolution par la danse et le chant, jusqu’à plus de voix. Nous sommes comme une vieille machine en route qui aurait fait peau neuve en se débarrassant des rouages et de la rouille. Pendant qu’au loin le vent frais dépose sur nos visages des milliers de petites gouttelettes d’espoirs qui laissent entrevoir une fenêtre nouvelle sous la plage.
- La révolution est toujours à penser et mener : Naviguons ensemble compagnons vers de nouveaux horizons et laissons les possibles se dessiner, les cimes pointent vers le renouveau.
Juliette Dana