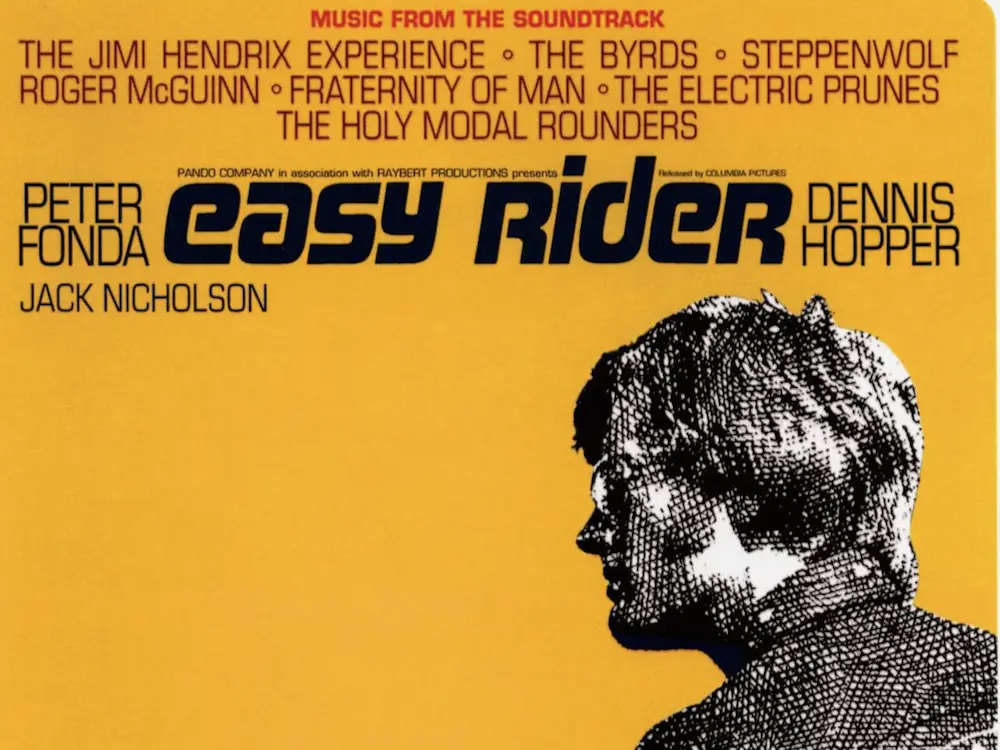Dj et producteur, pionnier de la techno de Détroit, Carl Craig s’apprête à inaugurer une résidence exceptionnelle avec le club parisien FVTVR, installé au 34 quai d’Austerlitz. À cette occasion, il replonge pour nous dans l’atmosphère bouillonnante du Motown des années 80, ses influences, son approche de la scène, et sa vision de la musique, entre racines et futurisme. Pour la première soirée, ce vendredi 9 février, on le retrouvera aux côtés du britannique Roni Size.
ZEWEED : Il se passait beaucoup de choses à Détroit dans les années 80, aussi bien sur le plan artistique, politique qu’économique. La techno aurait-elle pu naître ailleurs que là bas ?
Carl Craig : Je ne pense pas. Pas de la façon dont on l’a faite. C’est comme le rap, il devait venir du Bronx, de Harlem et de Brooklyn. Le rap devait naître d’une ville où les gens vivent les uns sur les autres. La techno devait naître d’une ville où pour trouver de la nourriture, des produis frais, il fallait faire 20 minutes de route, sortir du quartier et gagner la banlieue. Les voitures, les robots, les usines automobiles, l’idée d’utiliser les nouvelles technologies ont eu une influence considérable sur nos imaginations.
ZW: Le jazz, la funk, le hip-hop, Kraftwerk, les synthés…Y a-t-il une impression ou une émotion particulière que tu gardes de ta jeunesse au milieu de tout ça ?
CC : J’ai ressenti quelque chose de très fort lorsque la chanson Charivari de A Number Of Names est sortie. Non seulement l’Electrifying Mojo l’a jouée dans son émission, mais c’était en plus des gars de mon quartier. Je me suis senti un peu comme dans le film Les Affranchis, quand ils découvrent que c’est un type qu’ils connaissent qui a fait le casse de la Lufthansa. Quand j’ai entendu Charivari à la radio, je me suis dit “ce sont les gars du quartier”. J’ai ressenti la même excitation quand j’étais enfant et que j’ai découvert que Cybotron venait de Détroit, quand mon cousin a lancé Technicolor (un projet en collaboration avec Juan Atkins, ndlr) ou quand j’ai regardé l’émission de télévision The Scene. Je savais qu’ils venaient tous de Détroit.
ZW: Depuis, tu es devenu l‘un des principaux ambassadeurs de la techno dans le monde. Quel message essayes-tu de faire passer en jouant dans tous ces endroits ?
CC : Je prêche le techno gospel. Je suis à la fois Dj et prêtre. Peu importe ce que je joue, si je joue quelque chose qui sonne plus comme de la tech house, c’est toujours de la techno pour moi parce que je le joue toujours avec un état d’esprit techno. Je fais tout ce qui me permet de jouer ma propre musique, sans essayer de me conformer au dancefloor ou aux gens. Si j’essayais de me conformer aux gens, ce serait trop difficile car tout le monde ne veut pas la même chose. Vendredi, j’étais à Berlin, samedi à Rome. En Italie, les gens apprécient la musique différemment, ils veulent entendre une ligne de basse déstructurée. Je remplis donc ma mission de prêtre techno et j’espère trouver un terrain d’entente avec le public pour qu’on puisse profiter de la soirée.

ZW : Pourrais-tu définir la techno, ou s’agit-il d’une attitude ?
CC : Je pense qu’il s’agit d’une attitude. Il est plus facile de définir le rap ou le rock. Public Enemy fait du rap, mais leur attitude est un hybride de rock and roll et de nationalisme noir. Le Wu-Tang Clan fait du rap, mais ils ont ce côté rock and roll, et ils mélangent cette attitude avec des rythmes hip hop et toutes sortes de gimmick. Avec la techno, il y a beaucoup de couleurs différentes. C’est comme le jazz. La mentalité de la techno, de mon point de vue, a à voir avec un truc futuriste, avec l’idée qu’aucune idée n’est hors de portée. Tout est possible.
ZW: Pourquoi est-il important que la techno reste underground ? Est-ce possible ?
CC : Elle doit rester underground. La techno que les gens considèrent comme de la musique commerciale est vraiment ringarde et je ne pense pas qu’elle ait une longue espérance de vie. Lorsque la musique reste underground, elle a la possibilité de grandir, grossir, de s’apaiser et d’émerger de nouveau. C’est pour ça que vous pouvez écouter un disque de Rhythm Is Rhythm pendant 30 ans, parce que c’est quelque chose qui n’a pas été cramé cent fois par jour à la radio ou été imité mille fois.
ZW : Tu es de retour à Paris pour une résidence à FVTVR. Qu’est-ce que ça fait de jouer dans cette ville?
CC : Il m’a fallu un peu de temps avant d’apprécier Paris à sa juste valeur. Je venais de Détroit, alors Paris à mes yeux était un peu comme ce gamin de l’école dont le père est riche et qui a tout. C’est après avoir surpris un combat de rue à Paris que je me suis dit “ok, j’aime vraiment cet endroit “. Cela a mis Paris au même niveau que ce à quoi j’étais habitué à Détroit.
ZW : Comment Détroit a-t-elle changé au cours des années où tu y as vécu ?
CC : C’est une bonne question. La criminalité et le taux d’homicide sont en baisse. C’est une excellente nouvelle pour Détroit. La ville s’est développé, avec de nouvelles constructions, des entreprises, beaucoup plus de restaurants, la culture alimentaire est meilleure, mais ça reste la même ville, il faut toujours prendre la voiture et parcourir une bonne distance pour trouver de la nourriture saine.

ZW : Tu as vu tes premiers concerts en aidant ton cousin à installer les lumières. Plus de 30 ans plus tard, les lumières ont également joué un rôle important dans toninstallation immersive Party/After-Party, présentée pour la première fois à la Dia Beacon en 2020, dans l’Etat de New York. Quelle est ton approche de la scène ?
CC : Tout ce que je fais est centré autour des ondes sonores. Mon travail, en tant que producteur, consiste à faire fonctionner ensemble des choses qui ne devraient pas. Pour en revenir à la lumière, dans Party/After-Party, elle est le résultat de ma collaboration avec John et Randy. Je ne suis pas arrivé avec une idée parfaitement définie de ce que je voulais. Mon idée de l’éclairage d’un club, c’est une pièce sombre et un stroboscope, parce que cela remonte à l’époque des fêtes dans les sous-sols, quand on éclairait avecdes phares comme ceux que l’on trouvait sur le toit des voitures de police.
ZW : Penses-tu que la techno sera toujours “strictement la musique du futur “, comme l’a dit Derrick May ?
CC : Oui, je pense. L’idée futuriste est ancrée dans la musique techno. Tout a commencé par là. Le rap a été conçu pour être la musique de son temps. Il n’a jamais été question de futurisme dans le rap. Dans l’électro, on parlait aussi de futurisme, Nucleus parlait de l’espace et de super-héros, c’est pourquoi l’électro et la techno vont vraiment de pair.
ZW : Qu’est-ce que ça représente pour toi de jouer avec des artistes tels que Roni Size, Joe Claussell, Moodyman et Kevin Saunderson ?
CC : C’est incroyable. Roni et Joe sont des personnes que je respecte depuis toujours, mais je n’avais presque jamais joué avec eux. Kevin et Moodyman sont mes frères, je les connais depuis presque aussi longtemps que mon propre frère. C‘est génial de faire ça avec eux. Nous pouvons diffuser le Detroit techno gospel au FVTVR à Paris.
Les 4 dates de Carl Craig à FVTVR :
- 9 FÉVRIER : Carl Craig présente «THE BEAT» avec Roni Size
- 10 FÉVRIER : Carl Craig présente «THE GROOVE» avec Joe Claussell
- 16 FÉVRIER : Carl Craig présente son all night long «THE MEGAMIX»
- 17 FÉVRIER : Carl Craig présente « DETROIT LOVE » avec Kevin Saunderson & Moodymann
FVTVR Insta : fvtvr_paris
Carl Craig Insta : carlcraignet