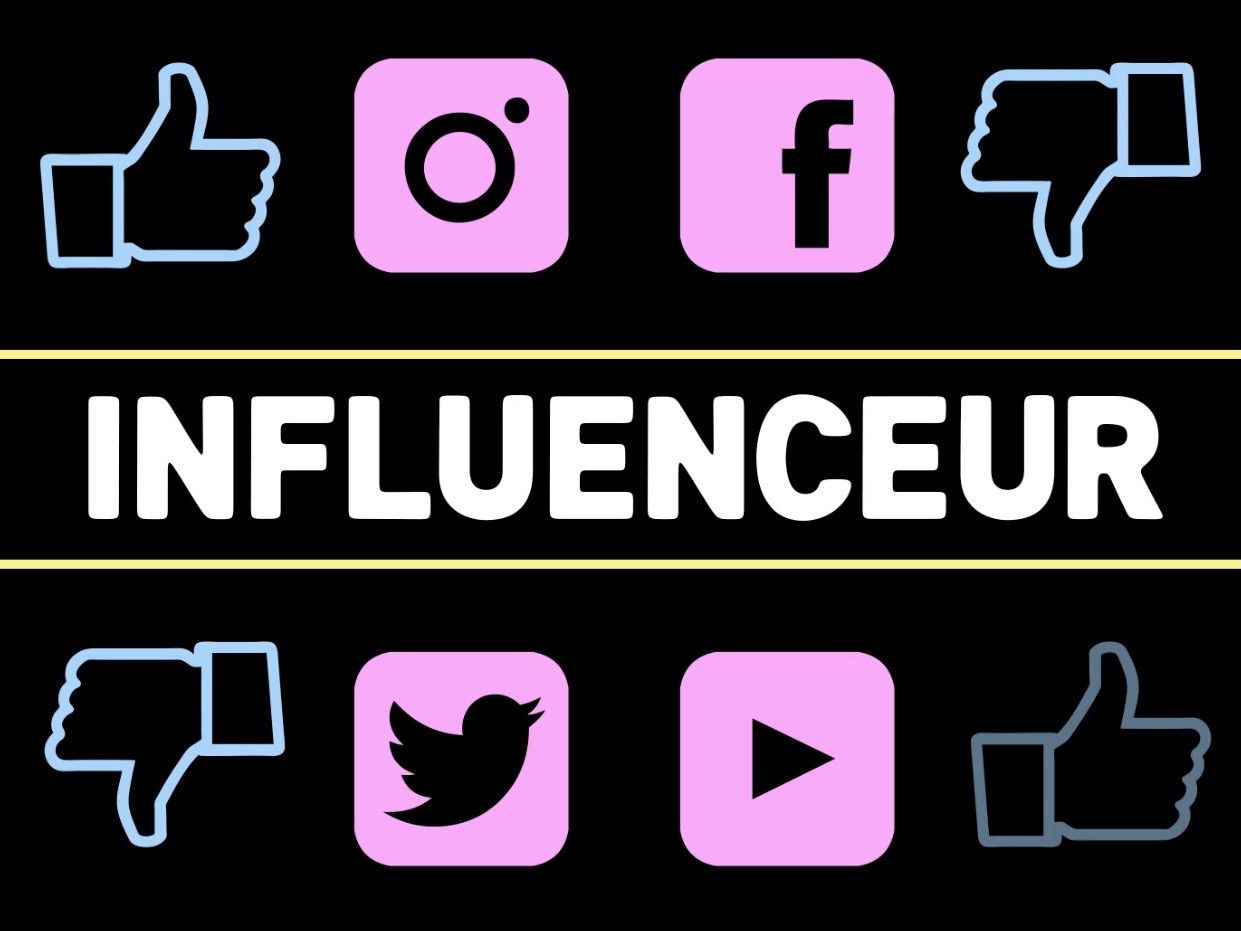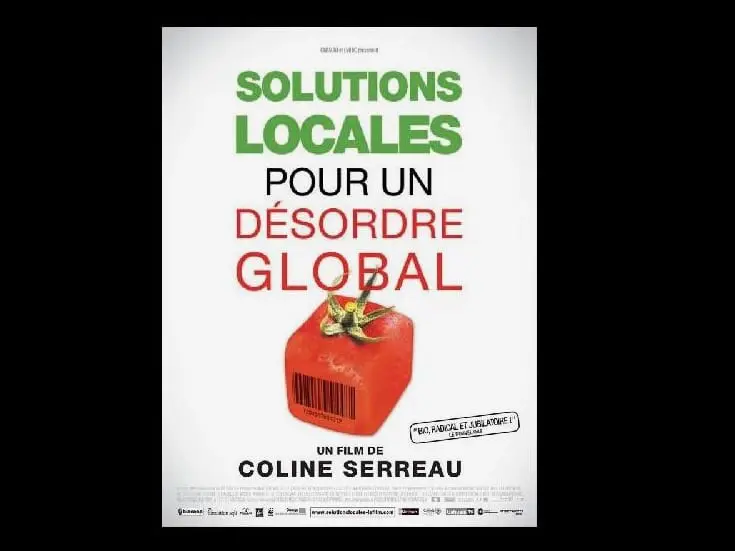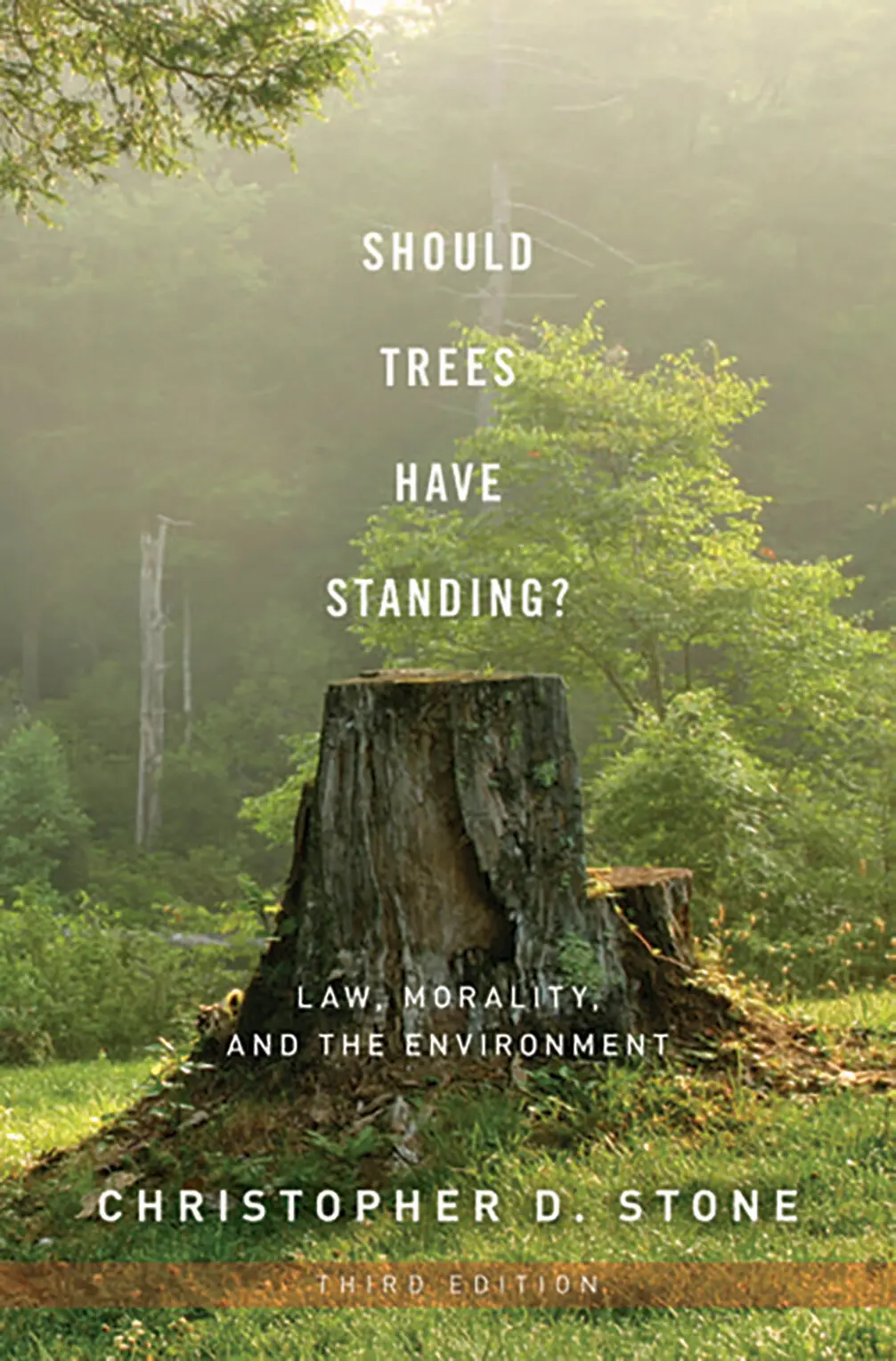La Californie a crée des appellations d’origine de cannabis. Un moyen pour dynamiser le business. Et le protéger aussi des chaleurs du réchauffement.
Depuis longtemps, on la désigne sous le nom de son pays d’origine : l’Afghane, la Marocaine ou la Libanaise. Ces sobriquets ne garantissent aux usagers ni la provenance réelle de leur weed favorite, ni sa qualité. Les Californiens devraient faire évoluer les choses. Le gouverneur du Golden State vient d’approuver une proposition de loi originale. Entrée en vigueur en octobre, la loi 67 introduit, en effet, la notion d’appellation d’origine pour la production de cannabis.
Exit indoor
Appellation d’origine, comme pour le vin ? C’est bien l’idée des législateurs. Pour donner un avantage concurrentiel aux productions made in California, la loi impose au ministère local de l’agriculture et de l’alimentation de présenter rapidement un cahier des charges pour l’inscription de ces nouvelles AOC. Etant entendu qu’elles ne s’appliqueront qu’aux plantations de pleine terre. Les cultivateurs indoor peuvent repasser.
La victoire du terroir
Si le nom de ces futurs « climats », « châteaux » ou autres domaines n’est pas encore reconnu, l’intérêt de cette classification saute aux yeux des professionnels. D’abord, protéger la réputation des meilleures zones de production, à l’image des vignobles de la Santa Maria Valley ou des Hautes-Côtes-de-Nuits.
Les planteurs veulent aussi populariser une idée bien française : le terroir. Imaginée par les commerçants français du XIIIe siècle, cette subtile alliance de la terre, du climat et du savoir-faire de l’agriculteur est gage de qualité et de spécificité. Jadis méprisé par les viticulteurs américains, le concept fait son chemin dans la Napa Valley et chez les producteurs d’herbe.
Donner envie
Classifier les plantations, c’est aussi susciter l’envie chez les consommateurs de découvrir les propriétés, ceux qui les exploitent et leurs productions. Les planteurs californiens rêvent d’ouvrir les routes de l’herbe, calquées sur celles du vin. Pas idiot, si l’on garde en tête que 3 millions d’amateurs sillonnent celles qui mènent à la Napa Valley, la région viticole la plus connue de Californie.
Mendocino first ?
Nul doute que les premières appellations devraient émerger du côté de Mendocino, ravissant bourg maritime situé à 250 km au nord de San Francisco. A la tête de l’Origins Council, Genine Coleman bataille pour créer l’AOC Mendocino. Avec son équipe de cultivateurs, de juristes et de commerciaux, la planteuse et spécialiste des arts martiaux fourbit ses argumentaires, dont certains s’appuient d’ailleurs sur des arrêts du Conseil d’Etat … français.
Carbone et biodiversité
Dans son esprit, la notion de d’appellation d’origine cannabique doit, bien sûr, encadrer les pratiques, garantir la qualité des produits, contribuer à la notoriété des produits. Plus étonnamment, l’Origins Council estime aussi que la notion de terroir, fut-il cannabique, est une réponse au changement climatique. A condition, par exemple, que le cahier des charges de l’appellation impose des pratiques culturales qui favorisent le stockage du carbone dans le sol, préservent la biodiversité des microorganismes de la terre (ce qui améliore la résilience des cultures !) et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Un postulat que les patrons de syndicats d’appellation vinicoles devraient reprendre à leur compte.
Alors que l’Allemagne a légalisé le cannabis le 1er avril, donnant aux petits producteurs toutes leurs chances de prospérer, il y a fort à parier que le vieux continent commence à proposer des appellation locales de grande qualité… En attendant que la France puisse se lancer sur ce fumant segment des AOC , qui font déjà la réputation des vins et fromages bleu-blanc-rouge dans le monde.