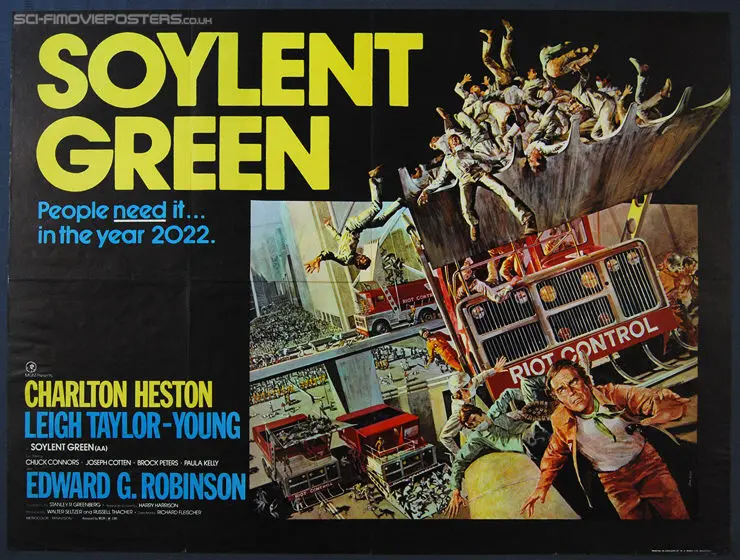Grand fumeur de joints devant l’Eternel, notre journaliste Hugo a troqué depuis quelques mois son THC pour du CBD. Et il en est ravi. Un choix sain pour bien commencer l’année, ou en tous cas entamer un vrai dry January.
A l’époque où j’ai commencé à fumer, il n’y avait à Paris que de la weed. Le THC, c’était trois consonnes que les intervenants de la brigade des stup’ essayaient d’inscrire dans nos têtes de collégiens, et le CBD, ça n’existait pas. J’avais 14 ans et une boulette de shit dénichée dans un tiroir du bureau de mon père. Je cherchais de l’argent, mais ma trouvaille avait beaucoup plus de valeur : j’allais pouvoir être un rebelle aux yeux de mes potes avec un truc qui n’allait pas me tuer — mes parents avaient du shit et une vie stable, une santé bonne, pourquoi pas moi ?
“fumer était devenu plus qu’une habitude, c’était une évidence de mon quotidien”
Au lycée, les occasions de fumer se sont multipliées avec les journées dans les parcs, les recoins des quais de Seine ou d’obscures ruelles, les soirées dans les appartements. A la fac, ayant quitté le foyer familial, c’était plus d’occasions dont il était question, mais de fumer ou ne pas fumer. J’étais libre, je pouvais faire ce que je voulais. Alors j’ai fait ce que je voulais. D’année en année, ma consommation a augmenté avec ma liberté, et, dans toute mon indépendance, j’étais devenu dépendant. Il n’y avait plus de choix, plus de question, fumer était devenu plus qu’une habitude, c’était une évidence de mon quotidien. Quand on fait quelque chose tous les jours pendant dix ans, on se demande ce qu’on pourrait bien faire d’autre. A part ne pas le faire.
Alors, il y a quatre mois, je me suis lancé dans l’aventure. Arrêter m’a vite rappelé à quoi la weed me servait. Avec elle, pas d’impatiences, pas de pensées tourbillonnantes, pas d’insomnies, pas de crises d’angoisse. Les symptômes du sevrage, m’a expliqué un spécialiste chez qui j’étais allé étaler mon désarroi. Avant qu’il me conseille d’en prendre, je pensais que le CBD était le summum de l’inutilité, un coup marketing pour des ados influençables et peureux. Suivant les conseils de l’expert, j’ai acheté dans une des très nombreuses boutiques de CBD de Paris un flacon d’huile de CBD. « 20% pour commencer, et si c’est pas assez, tu reviens, je te mets un 30% ». Chaleureuse, cette façon de garder un peu du parler des dealers. On m’a recommandé cinq gouttes sous la langue trois fois par jour, si bien que je me baladais partout avec mon petit flacon qui ressemblait drôlement à une tétine. Quelques semaines plus tard, je regardais la petite tétine avec des yeux reconnaissants. Placébo ou non, peu m’importe : après 8 heures de sommeil, je me réveille les idées claires alors que j’émergeais avant dans des brumes matinales qui ne se dissipaient qu’après le déjeuner. J’avais troqué contre les crises d’angoisse le niveau d’anxiété normal et réconfortant d’un Parisien lambda, et le THC devenait de l’histoire ancienne. Se voir changer grâce à un effort qu’on fait consciemment tous les jours, c’est comme prendre du muscle en allant à la salle, c’est gratifiant.
“Placébo ou non, peu m’importe : après 8 heures de sommeil, je me réveille les idées claires alors que j’émergeais avant dans des brumes matinales qui ne se dissipaient qu’après le déjeuner”
Aujourd’hui, c’est des mois qui sont passés, et le lointain souvenir des joints qui m’assommaient ne me manque plus du tout. Le plaisir de fumer de l’herbe, en revanche, oui. Mais la bonne nouvelle, c’est que maintenant que je suis capable de passer des journées sans ma tétine d’huile de CBD, je fume de temps en temps cette herbe qui ne défonce pas. Le joint de CBD que j’ai roulé de mes mains expertes ressemble à ceux que j’ai fumés de mes 14 à 24 ans : la taille, la forme, l’odeur, le goût. Une ressemblance de surface, mais justement un peu de légèreté ça fait du bien. Outre le fait de m’avoir aidé à retrouver une stabilité mentale et émotionnelle, la consommation de CBD s’est accompagnée chez moi d’autres changements réjouissants. C’est incroyable, mais maintenant, je fais du sport tous les deux jours, je me souviens intégralement des films que je regarde et des livres que je lis, je n’ai plus jamais raté une soirée à cause d’une angoisse sociale maquillée en paresse, et à ces soirées, je parle. Tant d’avantages d’une bienheureuse transition que je vous raconterai plus en détails dans les épisodes à venir de cette chronique fumeuse.