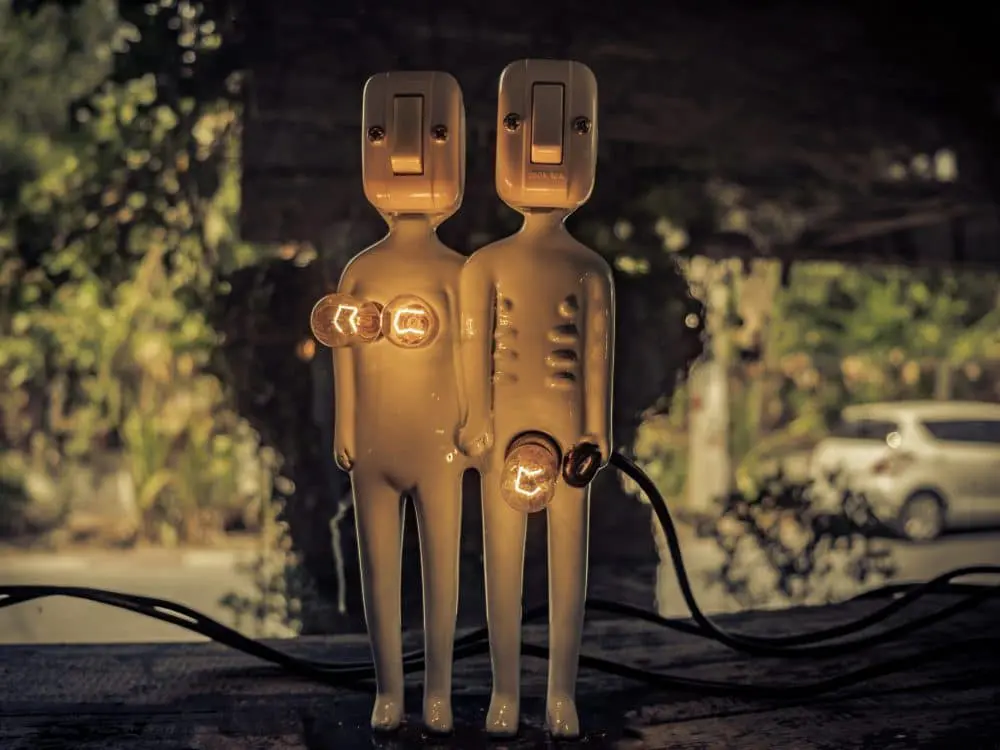Ariel, notre correspond au Liban, a divisé en 4 papiers sa dernière aventure pour le moins fascinante sur les terres de Beyrouth. Voici l’épisode 2 de Tripoli Express.
Après avoir été arrêtés au checkpoint sur l’autoroute et menottés, Antoine, Karim et moi marchions en file indienne, escortés par quatre soldats, vers un grand pick-up noir mat. Les mains attachées, je peinai à me hisser à l’arrière du pick-up. Un militaire me hurlait d’accélérer, je tombai en avant sur le sol du coffre, et à ce moment précis, je me demandai comment une si petite quantité de hasch avait pu me mener jusqu’ici. Puisque nos téléphones avaient été confisqués et éteints dès l’arrestation, que même nos montres avaient été saisies, nous n’avions plus aucune notion du temps. Il faisait noir et très froid, nous grelottions sous nos t-shirts les soldats avaient refusé que nous récupérions nos manteau, acculés sur des petites banquettes, pendant que le pick-up fusait sur l’autoroute. Karim semblait converser, négocier, avec un des soldats. Antoine me fit la traduction : le soldat disait qu’il regrettait la situation, que les lois du pays sont faites ainsi et que le gouvernement ne fait rien pour les changer. Que si ça ne tenait qu’à lui, il reçevrait avec plaisir un pot-de-vin des parents de Karim, mais que là où ils nous emmenaient, il y avait des caméras partout, c’était trop risqué pour lui. Je demandai où nous allions. Un des soldats rétorqua froidement : “A Baalbek”. Baalbek est la grande ville la plus proche de la frontière syrienne est, une région actuellement sous le contrôle du Hezbollah. Mon visage a dû pâlir d’un coup, puisque le soldat a éclaté de rire. “Mais non… On va à Tripoli”. Devait-ce être rassurant ?
Le pick-up s’arrêta dans la station de police de Batroun, sur le chemin entre Beyrouth et Tripoli. On fit descendre Karim, le “coupable”, et Antoine et moi attendions, de plus en plus perdus, dans le coffre. Soudainement, un crâne luisant apparut dans l’ouverture du coffre et demanda qui était le Français présent dans cette voiture. Je lui expliquai ensuite que j’étais au Liban en tant que journaliste culturel. J’étais prêt à descendre du pick-up et à me faire ramener chez moi par ce monsieur, mais en fait, il semble qu’il n’était venu que pour me dire : “Ah, la culture… C’est bien le haschich pour la culture hein ?”, et il disparut. Karim remonta dans le pick-up, silencieux, et le moteur redémarra, direction Tripoli. Frigorifiés, épuisés, angoissés, mes amis et moi n’avions plus rien à nous dire, car nous ne comprenions plus rien, il fallait attendre, subir.
Dans la nuit, Tripoli est déserte, muette.
J’essayais de comprendre où nous étions dans la ville, tentant vainement de me raccrocher à des choses connues. Le pick-up se gara devant un immeuble qui prenait la forme d’un gros bloc de béton défraichi. Les soldats donnèrent le relai à des hommes qui portaient tous des blousons en cuir et des jeans troués. Ils nous escortèrent à l’intérieur d’un semblant de poste de police. Les blagues en arabe à mon sujet, les regards menaçants, les gestes et paroles brusques étaient déjà devenues habituelles, obligées. Ils nous séparèrent pour enclencher une série de procédures. D’abord, un homme peignit en rouge sur un carton mon nom en alphabet arabe, puis me le mit entre les mains. Il tira mon portrait, de face et de profil. Après les menottes, le mugshot. Ensuite, on m’assit dans un bureau face à un autre homme qui écrivait sans me prêter attention. Soudainement, il s’adressa à moi dans un français impeccable, et l’interrogatoire démarra. Outre les questions évidentes, il me demanda quelle était ma religion, la fréquence de mes rapports sexuels, la teneur de ma consommation de drogues, et si j’aimais le Liban. Je me fis tout petit et obéissant, et je lui demandai si je pouvais appeler mon ambassade. Une question que je répétai, le long de la nuit, une dizaine de fois, pour toujours la même réponse : “Quinze minutes”. Entre temps, je fus poussé vers une cellule. Derrière les barreaux, je pouvais voir les visages terrifiés de mes deux amis. Un jeune type ouvrit la porte, me poussa à l’intérieur, et pendant qu’il refermait les barreaux sur moi, il me regarda en souriant et me dit : “Welcome to Lebanon”. Foutu pour foutu, je me mis à crier, mains agrippées aux barreaux, que j’avais le droit de parler à mon ambassade. On me répondit d’un cri bien plus sonore qui, traduit par mes amis, se rapprochait d’un simple et efficace Ferme ta gueule.
Il était temps d’accepter que la cellule soit ma chambre pour la nuit. Contre le sol humide et granuleux, une dizaine d’hommes, des adolescents autant que des grands-pères, étaient allongés. Nous prîmes place timidement à leurs côtés, et ils nous passèrent de grosses couvertures. L’heure n’était pas à l’hygiène. Les toilettes à la turque se tenaient, après tout, à pas plus d’un mètre de ma tête. En m’engouffrant sous la couverture, je vis une étiquette du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Quel voyage elle avait dû faire, cette couverture ? Complètement recroquevillé sur le sol, dans un coin de la cellule, je baignais dans un état second, celui de l’incertitude la plus totale. À nouveau, il fallait se raccrocher à des choses simples : dormir. La télévision du gardien resta allumée toute la nuit, de même qu’un spot lumineux dans la cellule, juste au-dessus de nos têtes, et à un certain moment, un sac en plastique rempli de pain vola à travers les barreaux et vint s’écraser directement sur ma tête. J’ouvris les yeux en sursaut : j’étais bel et bien encore là, dans une cellule de prison à Tripoli.
Ariel